publié le 25 juin 2021
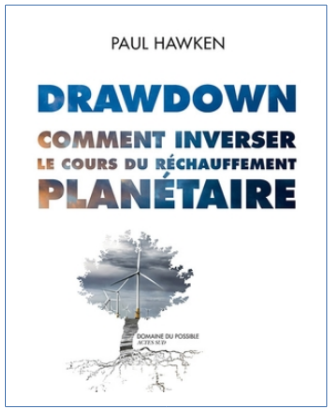
La concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère est aujourd’hui 50 % plus élevée qu’à l’ère industrielle 1, et la température supérieure de 1,1°. Les pays participants à l’Accord de Paris se sont engagés à limiter la hausse des températures à 2° voire 1,5°, ce qui implique de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 25 % voire 50 % d’ici 2030, et d’atteindre la neutralité carbone2 d’ici 2070 voire 2050. Ces émissions, qui n’ont cessé d’augmenté depuis le début de l’ère industrielle, ont atteint 38 gigatonnes en 20183.
Pour Paul Hawken, écologiste américain et spécialiste du climat, réduire nos émissions de gaz à effet de serre voire arriver à la neutralité carbone sont des objectifs insuffisants. Le seul objectif logique et mobilisateur pour l’humanité est d’inverser le cours du réchauffement planétaire. Rien de moins !
Lorsque l’on est engagé sur une mauvaise voie, il ne suffit pas de ralentir, il faut changer de chemin, nous dit-il. La neutralité carbone est donc une étape, le point de bascule à partir duquel la quantité de dioxyde carbone émise doit continuer de diminuer pour devenir plus faible que celle absorbée. A partir de ce point de bascule (drawdown en anglais), la concentration en gaz à effet de serre de notre atmosphère commencera à baisser. Le défi que nous devons relever est de mettre en place des solutions qui nous permettent de passer ce point avant 2050, puis ensuite de faire en sorte que soit absorbé plus de gaz à effet de serre que nous n’en émettons.
Pour démontrer la faisabilité d’un tel défi, Paul Hawken a décidé d’inventorier toutes les solutions existantes et d’en évaluer l’efficacité et le coût. Pour réaliser cette tâche, il a lancé un appel auprès d’étudiants et de chercheurs du monde entier. Ainsi est née l’association Drawdown, forte de 70 chercheurs.
Le projet de l’association était de recenser, mesurer et modéliser 100 solutions. Ensemble, ils ont établi la liste exhaustive des solutions existantes contribuant à lutter contre le réchauffement climatique. Ils ont retenu celles qui avaient le plus de chance d’être efficaces, ont rassemblé toutes les études existantes les concernant, et ont conçu des modèles climatiques et financiers pour chacune. Au final, 80 ont été jugées suffisamment éprouvées et déployables à grande échelle pour être conservées dans les trois scénarios qu’ils ont étudiés.
Le premier scénario est basé sur des prévisions optimistes mais sans plus du développement de chacune des solutions. Il conduit au bout de trente années à éviter ou à retirer 1051 gigatonnes de dioxyde de carbone, par rapport à un scénario de référence où rien ne serait fait.
Le second scénario est fondé sur des prévisions plus volontaristes, avec notamment une électricité entièrement décarbonée à l’horizon 2050. Ce scénario permet d’éviter ou capter 1442 gigatonnes de dioxyde de carbone en trente ans ; il est appelé le scénario Drawdown, car il permet d’atteindre le point de bascule en 2050, avec cette année-là non plus une augmentation mais une légère réduction (de 0,59 gigatonnes) de dioxyde de carbone atmosphérique.
Enfin le troisième scénario prend en compte le potentiel le plus offensif des solutions, avec notamment 100 % d’énergies renouvelables en 2050. Dans ce scénario, dit optimal, ce sont 1612 gigatonnes de dioxyde de carbone qui seraient évitées d’ici à 2050, et le point de bascule serait atteint dès 2045.
Pour faire connaître ces solutions, Paul Hawken a publié en 2018 Drawdown – Comment inverser le cours du réchauffement planétaire. Ce livre se veut didactique, accessible à tous. Son objet n’est pas de présenter les calculs et les modélisations réalisées par l’association, mais de promouvoir ces solutions auprès du public et des décideurs, en soulignant le degré d’efficacité de chacune au regard des émissions de gaz à effet de serre. Un classement suivant ce critère est donc établi. Ce classement ne doit pas faire oublier que, pour parvenir au drawdown, nous avons besoin de toutes les solutions, même les moins efficaces. Mais il a le grand mérite de mettre en avant celles que les politiques publiques ne doivent pas oublier car elles offrent le plus fort levier.
Ce livre n’est pas un plan d’action en soi, mais il propose aux décideurs de tous horizons les éléments pour construire leur feuille de route. Espérons, comme le souhaite Cyril Dion4 dans la préface, qu’ils s’en saisissent.
Chaque solution est présentée en quelques pages qui rappellent son histoire, expliquent son fonctionnement, et en donnent des exemples illustrés. Pour chacune un encadré indique les prévisions de son développement, son classement et son potentiel de réduction ou de captation de dioxyde de carbone, ainsi que son coût (investissement plus fonctionnement pendant trente ans) et les économies induites sur trente ans. Les données de ces encadrés sont celle du premier scénario. Il faut souligner que la plupart des solutions sont économiquement très rentables et que, pour beaucoup, le temps de retour sur investissement est même très court. Au global, le coût du premier scénario est estimé à 29 620 milliards de dollars, et les économies à 75 305 milliards de dollars.
Les 80 solutions modélisées sont rassemblées en sept secteurs aux dénominations parfois inattendues: l’alimentation, l’énergie, l’affectation des terres, femmes et filles, matériaux, bâtiments et villes, et transports. Un chapitre spécifique présente les 20 solutions encore en devenir, non prises en compte dans les scénarios, mais pouvant devenir de nouveaux leviers à l’avenir. Au fil des chapitres, on trouve des textes de journalistes, écrivains ou scientifiques qui viennent éclairer le contexte des solutions.
L’alimentation est la première des causes du réchauffement climatique, et donc le plus fort levier pour l’inverser. La moitié du potentiel de ce secteur repose sur l’évolution des pratiques agricoles : le développement des diverses méthodes d’agroécologie (agriculture régénératrice, sylvopastoralisme, agroforesterie, cultures pérennes plutôt qu’annuelles, etc), et une meilleure gestion des pratiques conventionnelles (riziculture améliorée pour limiter les émissions de méthane , gestion des pâturages, limitation de la sur-utilisation des engrais, irrigation au goutte à goutte). Pour autant, les deux actions les plus efficaces de ce secteur en termes de réduction de gaz à effet de serre sont la lutte contre le gaspillage alimentaire et une alimentation plus raisonnée (c’est à dire limitée à 2 500 calories par jour et plus riche en végétaux). En outre, la généralisation de l’usage de cuisinières au bois plus propres aurait un effet non négligeable sur les émissions de dioxyde de carbone mais aussi sur la santé des populations concernées5.
Réduire les émissions de la production énergétique passe bien sûr par les énergies renouvelables. Pour la production d’électricité, il s’agit de démultiplier les éoliennes terrestres et en mer, les centrales solaires et les toitures photovoltaïques, les centrales solaires thermodynamiques 6, les centrales houlomotrices et marémotrices, la micro-hydroélectricité 7. En parallèle les réseaux de distribution électriques doivent être rendus plus flexibles, en combinant différents modes de production selon les secteurs géographiques, en développant les capacités de stockage centralisées ou non, et en recourant aux systèmes d’adaptation de la production à la demande.
Sont également à développer fortement la géothermie, le chauffage solaire de l’eau et les digesteurs anaérobies (qui permettent de produire du biogaz et de l’engrais riche en nutriments par la décomposition sans oxygène de déchets organiques). Il existe d’autres solutions peu émettrices, mais que Paul Hawken juge non souhaitables à terme en raison de leur autres impacts : le nucléaire, la production d’électricité par la combustion de biomasse, la cogénération et l’incinération des déchets. Une légère augmentation du recours à ces solutions est toutefois prévue, en attendant que la flexibilité des réseaux et la production d’énergies renouvelables soient suffisantes pour permettre d’y renoncer.
L’affectation des terres regroupe essentiellement des actions qui visent à sauvegarder et renforcer les puits de carbone : réhabiliter et préserver les forêts tropicales ou tempérées, reboiser des terres peu productives selon la méthode d’Arika Myawaki8, protéger largement les tourbières et les milieux côtiers humides (marais, mangroves et herbes marines). Parmi les solutions visant à préserver les forêts, notons la sécurisation de la propriété foncière des peuples autochtones qui les habitent et en prennent soin. Il est également proposé que la production de biocarburant, dans la mesure où elle reste nécessaire pour certains usages, soit faite à partir de culture pérenne (plantation et recépage de ligneux type saules, peuplier ou eucalyptus), plutôt que de cultures annuelles type maïs. Enfin la culture de bambou, au fort pouvoir de captation de carbone et aux multiples usages, devrait être développée (avec la prudence que requiert son caractère invasif).
L’émancipation des femmes et des filles mérite d’être poursuivie comme un but en soi, nécessaire à la défense de leur droits et libertés. Il n’en reste pas moins que ce levier est majeur pour réduire les émissions anthropiques, en raison de la modération de la croissance de la population mondiale qu’il induit. En finançant l’éducation de toutes les filles jusqu’au secondaire, et en doublant le financement de la planification familiale, on œuvre pour leur émancipation, pour l’amélioration de la situation socio-économique de leur pays – et aussi, incidemment mais massivement, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, les femmes qui sont à la tête de petites exploitations agricoles dans les pays pauvres ont un accès réduit à la terre comme au capital, ce qui nuit au rendement de leur exploitation ; leur donner un accès équivalent à celui des hommes accroît ce rendement, donc limite le besoin de terres et ainsi la déforestation et les émissions de dioxyde de carbone qu’elle induit.
C’est dans le secteur des matériaux que l’on trouve la solution qui est première au classement général. Il s’agit de l’élimination des fluides frigorigènes, qui représente à elle seule 80 % des gains d’émissions de l’ensemble des solutions du secteur des matériaux. Les hydrofluorocarbures, utilisés dans les réfrigérateurs, congélateurs ou climatiseurs, ont une capacité de réchauffement de l’atmosphère 1000 à 9000 fois plus élevée que le dioxyde de carbone. L’accord de Kigali, signé par 170 pays en 2016 impose leur suppression pour les appareils neufs9 entre 2019 et 2028 (suivant la richesse du pays). Reste que le stock est énorme et que les émissions se produisent à la fin de la vie des appareils : cette action consiste donc à récupérer et détruire ces fluides. Un autre axe d’action, plus connu mais qui reste à généraliser dans nombre de pays, est le recyclage des déchets ménagers et industriels ainsi que du papier. On trouve également dans cette section le développement des bioplastiques ou du ciment alternatif, et la généralisation des robinets et pommes de douche à faible débit.
Les solutions du secteur bâtiments et villes peuvent être regroupées en trois sous-secteurs. Le premier consiste à aménager la ville pour la rendre attractive aux piétons et aux cyclistes. Le deuxième vise à rendre les bâtiments économes en énergie, en généralisant l’isolation voire la rénovation complète, les toitures végétalisées ou fraîches 10, ainsi que tous les équipements qui réduisent la consommation d’énergie (éclairage par des diodes électroluminescentes, pompes à chaleur, thermostats intelligents, vitrages intelligents, voire automatisation complète de la gestion thermique du bâtiment) ; pour le neuf, l’objectif est de développer les bâtiments autonomes en énergie. Dans le troisième sous-secteur, on trouve le développement du chauffage urbain, la valorisation du méthane des décharges (tant qu’il en existe) ou encore l’équipement des réseaux de distribution d’eau par des dispositifs qui limitent les fuites.
Les solutions pour réduire les émissions du transport de personnes ou de marchandises sont de deux natures. La première consiste à décarboner les moyens de transport ou à en améliorer l’efficacité : augmenter plus fortement la part des véhicules électriques ou hybrides, moderniser les navires, les camions et les avions, électrifier plus rapidement les voies ferrées. La seconde vise à faire évoluer les modalités de transport : développer l’usage des vélos électriques et des transports en commun et poursuivre la création de lignes à grande vitesse11.
J’ai trouvé intéressant de regarder la contribution de chacun des sept domaines au bilan du premier scénario (qui conduit à une réduction du dioxyde de carbone émis de 1051 gigatonnes en trente ans), et je trouve le résultat assez surprenant, comparé aux pistes d’actions dont on entend le plus parler au quotidien. Le premier secteur est l’alimentation, qui contribue à hauteur de 31 % ; le second l’énergie avec 23 %; le troisième est l’affectation des terres avec 14 %; le quatrième, « femmes et filles », représente 12 %; il est suivi du secteur des matériaux pour 11 %; viennent enfin les domaines « bâtiments et villes avec 5 % et « transports » avec 4 %.
Le classement des solutions, prises individuellement, est lui aussi plutôt étonnant. Citons dans l’ordre les quinze premières – sans oublier que toutes sont nécessaires pour atteindre l’objectif : les fluides frigorigènes, les éoliennes terrestres, la réduction du gaspillage alimentaire, une alimentation riche en végétaux, la protection des forêts tropicales, l’éducation des filles, la planification familiale, les centrales solaires, le sylvopastoralisme, les toitures photovoltaïques, l’agriculture régénératrice, la protection des forêts tempérées, les tourbières, l’arboriculture, le boisement. Ces solutions représentent les deux tiers du bilan du premier scénario. Il est bon de l’avoir à l’esprit lorsque l’une d’entre elle est négligée voire dénigrée.
Les actions retenues relèvent de deux stratégies complémentaires : la première consiste à baisser drastiquement les émissions anthropiques et la seconde à généraliser les pratiques éprouvées permettant de capter le carbone présent dans l’air et de le stocker. Cette seconde stratégie repose essentiellement sur les secteurs de l’alimentation et de l’affectation des terres.
Les arbres jouent un rôle fondamental dans cette stratégie. L’ensemble des actions qui consistent à protéger les forêt ou à réintroduire des arbres représente 20% du bilan du premier scénario. Deux des ouvrages cités dans Drawdown nous parlent d’ailleurs des arbres. Dans le premier, Chaud devant, la vie sur terre ces cinquante prochaines années, Maark Hertsgaard raconte l’histoire de « l’homme qui arrêta le désert ». Cet homme, un paysan du Burkina Faso nommé Yacouba Sawadogo, inventa une nouvelle façon de cultiver la terre : il agrandit les rigoles traditionnellement utilisées pour retenir l’eau et les emplit de fumier et des arbres naquirent des graines contenu dans ce fumier ; ses rendements se sont multipliés et sa méthode s’est largement répandue, éloignant le spectre de la désertification. Dans le second, La vie secrète des arbres, Peter Wohlleben explique comment il a découvert la vie sociale des arbres, et leur façon de s’entraider pour survivre.
Si nous savons les comprendre, les arbres sont nos alliés pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour améliorer l’humidification des sols, la couverture nuageuse, les rendements agricoles, la biodiversité, la santé humaine, les revenus des agriculteurs …
La conviction de Paul Hawken est que nous ne pourrons réussir à renverser le cours du changement climatique qu’en créant un mouvement d’entraide et de collaboration, ces moteurs qui sont déjà à l’origine de la plupart des solutions présentées. Il suffirait, selon Bill Mac Kibben12, que se mobilise 5 à 10 % de la population. La vocation de Drawdown est d’alimenter un tel mouvement.
On pourra certes objecter que cet ouvrage fait l’impasse sur des questions comme la disponibilité des matières premières nécessaires à certaines des solutions. Mais il apporte néanmoins un éclairage essentiel sur les priorités que nous devons nous donner et les impasses à ne surtout pas faire, et surtout nous donne l’espoir que nous pouvons relever le défi.
Le projet Drawdown se poursuit, les modélisations sont constamment mises à jour ou affinées. Vous pouvez le suivre sur son site internet : https://www.drawdown.org/
Les données figurant dans cet article sont celles du livre, publié en 2018 ; celles du site, plus récentes, peuvent différer quelque peu.
S.F.G.
1 De 278 ppm (parties par million) en à la fin du 18ème siècle, le taux de CO2 dans l’atmosphère dépasse maintenant les 415 ppm.
2 La neutralité carbone signifie que les émissions de gaz à effet de serre sont entièrement compensées par les absorptions
3Chiffres issus de Rouge carbone, de Laurent Fabius
4 Cyril Dion est écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français, réalisateur du documentaire Demain, auteur du Petit manuel de résistance contemporaine, et garant de la Convention Citoyenne pour le Climat
5 Les fumées et les suies émises par le cuisinières rudimentaires sont responsables de la mort prématurée de 4,3 millions de personnes chaque année, essentiellement des femmes et des enfants
6 Dans ces centrales, les rayons du soleil, concentrés par des miroirs, chauffent un fluides, produisant de la vapeur qui actionne des turbines ; l’intérêt est que la chaleur est plus aisée à stocker que l’électricité.
7 Sorte de roues à aubes modernes
8 Cette méthode consiste à planter suivant un canevas très dense des dizaines d’essences forestières locales et de la flore indigène ; après deux années oùil est nécessaire d’arroser et désherber, les forêts sont autonomes et deviennet matures infiniment plus vite qu’une forêt spontanée, en dix à vingt ans seulement
9 Les nouveaux appareils utilisent une nouvelle génération de fluide, les HFO (Hidro Fluoro Oleofine)
10 Les toitures fraîches sont réalisées en matériaux clairs
11 Notamment en Asie
12 Scientifique mobilisé dans l’éducation des populations en matière de changement climatique
Merci Sylvie cet envoi m’a permis d’envoyer l’adresse de ton blog à beaucoup d’autres personnes que j’avais oubliées dans mes précédents envois. J’espère que ton travail sera connu peu à peu Quand nous verrons nous ? en attendant, BON ANNIVERSAIRE et je te fais une grosse bise à cette occasion à plus JM
J’aimeJ’aime
Il me semble qu’il y a un gros oubli que je présenterai bientôt. Mais beau travail apprécié
J’aimeJ’aime