Les nations face aux crises et au changement
Publié le 4 janvier 2024
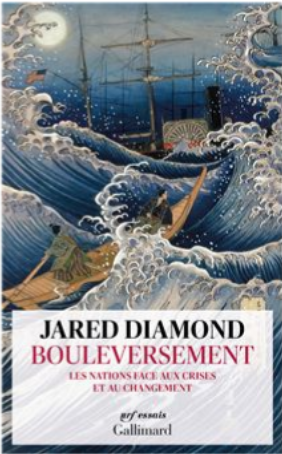
Présentation
Jared Diamond est biologiste, physiologiste, professeur de géographie et historien de l’environnement. Il a publié plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, dont Le troisième chimpanzé (1991), De l’inégalité entre les sociétés (1998), et Effondrement – Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie – (2005), livre dont j’ai proposé une recension dans mon dernier article.
En 2019 est paru Bouleversement – Les nations face aux crises et au changement. Jared Diamond explore dans cet ouvrage comment certaines sociétés contemporaines ont surmonté les crises qu’elles ont eu à affronter, ainsi que les facteurs qui leur ont permis d’y parvenir.
Le facteur essentiel est pour lui la capacité à effectuer des changements sélectifs, c’est à dire à discerner ce qui dans la société peut être conservé et ce qui doit être modifié. C’est la clef pour s’adapter à des événements qui viennent bouleverser la nation.
Ce livre est une « étude comparative, narrative et exploratoire des crises et des changements sélectifs » survenus dans six nations, nations qu’il a choisies car il les connaît bien : la Finlande, la Japon, le Chili, l’Indonésie, l’Allemagne, l’Australie.
Les deux premières (Finlande et Japon) ont connu des crises soudaines externes, les deux suivantes (Chili et Indonésie) des crises soudaines internes, et les deux dernières (Allemagne et Australie) des crises qui se sont développées progressivement.
Cette analyse est complétée par une réflexion sur les crises actuelles et futures que doivent affronter le Japon, les États Unis, et le monde dans son entier.
La suite de cet article propose un résumé du livre, puis, en guise de conclusion, quelques lignes sur ce que j’en retiens.
Résumé
Première partie : les individus
Pour déterminer les facteurs pouvant influer sur la capacité d’une nation à surmonter une crise, Jared Diamond s’est inspiré des travaux sur les crises personnelles, notamment ceux conduits par le psychiatre Erich Lindermann après l’incendie du Cocoanut Groven à Boston.
Les spécialistes ont identifié 12 facteurs qui influent sur le dénouement d’une crise personnelle :
- reconnaître qu’on traverse une crise
- reconnaître sa part de responsabilité et endosser la responsabilité de résoudre la crise
- construire une clôture pour circonscrire les problèmes précis à résoudre
- obtenir de l’aide matérielle et émotionnelle de la part d’autres individus ou d’un groupe
- s’inspirer des modèles que représentent d’autres personnes pour résoudre des problèmes
- la force du moi, c’est à dire la capacité de supporter les émotions fortes, de percevoir la réalité avec justesse et de prendre des décisions censées
- l’auto-évaluation honnête de ses forces et de ses faiblesses
- l’expérience de crises personnelles antérieures (facteur qui explique pourquoi les crises sont plus traumatiques pour les adolescents et jeunes adultes)
- la patience, c’est à dire la capacité à tolérer l’incertitude, l’ambiguïté ou l’échec lors des premières tentatives de changements
- la flexibilité
- les valeurs fondamentales individuelles, c’est à dire les croyances et convictions que l’on considère essentielles à son identité ; ces valeurs peuvent aider en étant une base solide et sûre à partir de laquelle on peut envisager de changer d’autres parties de soi, ou au contraire être un handicap si elles sont inadaptées au contexte nouveau qui s’impose
- l’absence de contraintes personnelles
De ces facteurs, Jared Diamond déduit ceux qui peuvent influer sur le dénouement d’une crise nationale :
- consensus national sur le fait que le pays traverse une crise
- reconnaissance qu’il est de la responsabilité de la nation d’agir
- construire une clôture pour circonscrire les problèmes nationaux à résoudre
- obtenir de l’aide matérielle et financière de la part d’autres nations
- s’inspirer des modèles que représentent d’autres pays
- l’identité nationale
- l’auto-évaluation honnête des forces et des faiblesses du pays
- l’expérience historique de crises nationales antérieures
- faire face à l’échec national
- la flexibilité nationale en fonction des situations
- les valeurs fondamentales nationales
- l’absence de contraintes géopolitiques
NB : dans ces deux listes la formulation des facteurs est telle qu’elle figure dans l’ouvrage
Deuxième partie – Les nations : des crises passées
La guerre entre la Finlande et l’Union Soviétique
Cette guerre connut deux phases : la guerre d’Hiver durant l’hiver 1939-1940, puis la guerre de Continuation de juin 1941 à septembre 1944. La première demeure encore aujourd’hui une source de fierté pour les Finlandais, qui opposèrent une résistance héroïque à l’envahisseur, malgré la perte d’un vaste territoire lors de l’armistice. A l’inverse elle fut ressentie comme une défaite par l’Union Soviétique, incapable de conquérir la Finlande malgré des forces très largement supérieures. Durant la guerre de Continuation, la Finlande tenta en vain de regagner ses territoires perdus en concluant une alliance de circonstance avec l’Allemagne.
Au final, cette guerre causa de grandes pertes à la Finlande : humaines (100 000 tués et 94 000 mutilés sur une population de 6 millions d’habitants seulement), territoriales (10% de sa superficie), et financières (en raison de lourdes réparations et de l’obligation de réaliser désormais 20% de son commerce avec l’Union Soviétique). Cependant, la Finlande échappa à l’annexion pure et simple, contrairement à l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Ce fut en soi une victoire, mais chèrement acquise. La Finlande décida donc d’éviter à l’avenir tout conflit avec son puissant voisin.
Ayant compris qu’elle ne serait en sécurité que si l’Union Soviétique se sentait elle-même en sécurité, elle élabora la « doctrine Paasikini-Kekkonen », du nom des présidents finlandais qui la développèrent. Le principe en était de comprendre le point de vue soviétique, de dialoguer, et de gagner puis de conserver la confiance de l’Union Soviétique, quitte à sacrifier une partie de son indépendance et de sa liberté d’expression. Cette doctrine fut appelée péjorativement la « finlandisation », mais elle permit à la Finlande de connaître la paix et la prospérité1.
La Finlande est l’exemple par excellence d’un pays qui a su reconnaître sa responsabilité, s’auto-évaluer de façon réaliste, et faire des changements sélectifs finalement limités. Elle a su reconnaître ses échecs et faire preuve de flexibilité. Elle a pu s’appuyer sur une identité nationale forte, basée notamment sur une langue singulière et difficile, et sur une valeur fondamentale : l’indépendance. Elle a dû faire face au manque de soutien de la part de ceux qu’elle pensait être ses alliés, et apprendre à intégrer la contrainte géopolitique majeure que représente sa longue frontière avec l’Union Soviétique.
Aux origines du Japon moderne
Le 8 juillet 1853, le commodore Matthew Perry s’introduisit dans la baie d’Edo (devenue Tokyo) avec quatre navires, dont deux équipés de canons. Il donna une année au Japon, jusque-là résolument isolationniste, pour répondre à une liste d’exigences destinées à l’ouvrir au commerce américain. Cet événement marqua le début de grands changements.
Perry revint en 1854, ouvrit deux ports au commerce et nomma un consul. Les britanniques, les russes et les néerlandais suivirent rapidement l’exemple américain. En 1858 le Japon dut signer des traités commerciaux, nommés « traités inégaux » tant ils lui étaient défavorables. La colère contre les étrangers et contre le shogun se développèrent, et conduisirent en 1868 à la fin du shogunat et à la restauration du pouvoir de l’empereur. Ainsi débuta l’ère Meiji.
Le nouveau gouvernement envoya 50 de ses membres en Occident visiter les usines et les différentes instances. Il s’inspira des modèles les plus efficaces pour concevoir la structure du Japon moderne : la constitution, le code civil, la marine et l’armée, l’industrie, le système bancaire et fiscal, l’éducation nationale… De tels changements impliquaient la disparition du système féodal et l’unification du pays, ce qui fut permis par le développement des valeurs communes : l’éducation, le devoir civique, la religion shintoïste, la philosophie confucéenne et le culte de l’empereur.
Le Japon surmonta cette crise, car il sut en prendre la mesure, et conduire les changements considérables qui s’imposaient en s’inspirant de modèles étrangers, tout en préservant des valeurs traditionnelles constitutive de son identité nationale.
Un Chili pour tous les chiliens
Dans les années 1960 le Chili était considéré – et se considérait lui-même – comme le pays le plus stable politiquement de toute l’Amérique latine. Il était pourtant à la veille d’une crise politique majeure.
En 1970 Salvador Allende, élu d’une courte majorité, engagea une politique socialiste radicale. Mais les difficultés économiques et politiques s’accumulèrent, d’autant plus que les États-Unis firent ce qui étaient en leur pouvoir pour les aggraver. Trois ans plus tard, l’opposition déclencha un coup d’État, installant une dictature militaire qui ne devait être que transitoire. Mais Pinochet conserva le pouvoir près de 17 ans, et se montra d’une extrême brutalité. La répression provoqua des milliers de tués ou disparus, des dizaines de milliers de personnes torturées et des centaines de milliers d’exilés.
Pinochet engagea une politique libérale radicale. La situation économique s’améliora pour les classes moyennes et supérieures, qui continuèrent de le soutenir malgré les violences. Elle se dégrada pour les autres, mais la répression empêcha toute révolte. Pinochet quitta le pouvoir en 1987, après avoir perdu le référendum de 1987 destiné à le maintenir, sans toutefois que ce résultat soit un rejet massif : 42% des chiliens avaient voté pour son maintien.
Le contexte de l’après-Pinochet fut difficile, car le peuple était encore très divisé entre ceux qui estimaient que la dictature avait malgré tout été une bonne chose pour le pays, et ceux qui pensaient que cela avait été une période horrible. Les gouvernements suivants surent cependant faire preuve de modération, autant dans le domaine économique que dans la nécessaire condamnation de ceux qui avaient tué ou torturé, et ils se montrèrent aptes à bâtir des compromis.
La crise fut surmontée grâce à une identité nationale très forte, à une bonne évaluation de la situation et à l’introduction d’une culture du compromis. A l’inverse, c’est une mauvaise évaluation de sa réelle liberté d’action, entravée par les États-Unis, et des choix trop radicaux qui avaient conduit Allende à l’échec.
L’Indonésie : naissance d’un nouveau pays
L’Indonésie a déclaré son indépendance le 17 août 1945 ; celle-ci fut effective en 1949, après la révolution contre les néerlandais. Ce jeune pays avait à relever deux défis : construire une unité nationale et apprendre la démocratie.
Le premier était particulièrement difficile, s’agissant du pays le plus morcelé du monde, avec des milliers d’îles habitées éparpillées sur 5 500 km d’ouest en est, plus de 700 langues, et une grande diversité de religions. Son unification, en tant que colonie néerlandaise, ne datait que de 1910. Ce défi fut relevé par le président Sukarno par l’inscription dans la constitution du « Panscasila », constitué de cinq principes : la croyance en un dieu unique, l’unité nationale, l’humanitarisme, la démocratie et la justice sociale.
Le second défi se révéla également ardu. Faute de savoir bâtir des compromis, le parlement, où quatre partis se partageaient les sièges, se trouva dans une impasse politique. Dès 1957, le président décréta la loi martiale, et mit en place une « démocratie guidée », où la moitié des parlementaires étaient nommés et non plus élus. En 1963, il fut nommé président à vie. Confiant en son charisme, Sukarno ne perçu pas la menace représentée par la lutte de pouvoir entre l’armée et le Parti communiste indonésien.
Une tentative de coup d’État se produisit le 1er octobre 1965. Imputée au Parti communiste indonésien, elle donna le prétexte à l’armée, conduite par le commandant Suharto, d’une répression terrible contre les communistes. Un demi-million de personnes furent tuées et 100 000 autres incarcérées pendant plus de dix ans.
Suharto supplanta progressivement Sukarno et devint président en 1968. Il instaura une dictature militaire, développa l’économie de marché et encouragea les investissements étrangers pour exploiter les ressources – pétrole et minéraux.
Trente ans plus tard, son régime finit par s’effondrer, sapé par la crise financière asiatique, mais aussi par l’exaspération des citoyens face à la corruption et à l’autoritarisme du pouvoir. En 1999 eurent lieu les premières élections libres depuis plus de quarante ans.
L’Indonésie a réussi à bâtir une identité nationale, basée sur la fierté d’avoir acquis son indépendance par la révolution contre les néerlandais et sur le « Panscasila ». Elle est finalement parvenue, après bien des difficultés, à mettre en place un régime démocratique et résorbe peu à peu la corruption qui la gangrenait. Mais elle n’a pas assumé la phase sombre de son histoire et la terrible répression exercée contre les communistes, qui n’a fait l’objet d’aucun procès et n’est que rarement évoquée dans le pays.
Reconstruire l’Allemagne
A l’issue de la seconde guerre mondiale, l’Allemagne était dévastée : des millions de morts et de disparus, les principales villes en ruine, une économie effondrée, une partie de son territoire perdu et le reste coupé en quatre secteurs d’occupation. De plus le caractère autoritaire de sa société avait été renforcé par douze ans de régime nazi.
Et pourtant, quarante-cinq ans plus tard, l’Allemagne était réunifiée, son économie était devenue la plus dynamique d’Europe, et sa société s’était largement libéralisée. Ce fut une reconstruction étonnamment rapide, mais qui s’explique au regard des facteurs qui influent sur le dénouement d’une crise nationale.
L’Allemagne sut reconnaître sa responsabilité dans cette terrible situation – ce qui n’avait pas été le cas au sortir de la première guerre mondiale. Le geste de Willy Brant, qui s’agenouilla devant le monument en mémoire des juifs tués dans le ghetto de Varsovie pour demander pardon au nom de l’Allemagne, est le symbole de cette reconnaissance. L’Allemagne prend à cœur aujourd’hui encore son devoir de mémoire, et tous les enfants y apprennent les crimes du régime nazi.
Elle sut évaluer avec justesse ses faiblesses, et notamment la contrainte que représente sa situation géographique, au carrefour de nombreux pays. Willy Brant renonça aux territoires perdus, et sut, ainsi que ses successeurs, rétablir des liens de coopération et de confiance avec les pays voisins, à l’est comme à l’ouest.
L’Allemagne put s’appuyer sur une identité et une fierté nationales restées fortes, fondées sur sa culture. En outre l’Allemagne de l’Ouest reçut une aide importante au titre du plan Marschall, dont elle sut faire un usage pertinent pour rebâtir son économie.
Enfin, elle a réussi à conduire les changements sélectifs exigés par la jeunesse de 1968, dont l’hostilité envers la génération précédente fut plus violente que dans les autres pays, en raison de la responsabilité de cette génération dans les exactions nazies et du caractère autoritaire encore très marqué de la société. Les libertés individuelles furent grandement élargies, mais en préservant des valeurs communautaires fortes.
Australie : qui sommes-nous ?
L’Australie demeura essentiellement britannique jusque dans les années 1960, de par sa composition démographique et ses liens affectifs, culturels et commerciaux avec la Grande Bretagne. C’était un pays pratiquant une politique raciste, non seulement à l’égard des aborigènes, massacrés et discriminés, mais aussi de toute personne non blanche – interdisant ainsi l’immigration des populations des pays les plus proches.
Pourtant, vingt ans plus tard, le Japon était devenu son principal partenaire commercial, plus de la moitié des australiens étaient nés à l’étranger ou avaient un parent né à l’étranger, et la moitié des immigrants étaient asiatiques.
Cette transformation semble avoir été soudaine, lorsque le nouveau gouvernement travailliste mit fin en 1972 à la politique de l’Australie blanche et à toutes les formes politiques de discrimination raciale, et qu’il adopta une politique étrangère propre et non plus alignée sur la Grande Bretagne 2. Le premier ministre de l’époque, Gough Whitlam, présentait cependant ses réformes comme la reconnaissance de ce qui avait déjà eu lieu.
En effet, l’Australie s’interrogeait sur son identité nationale et ses valeurs fondamentales depuis la seconde guerre mondiale. Elle ne pouvait plus se considérer comme un avant-poste britannique blanc à la frontière de l’Asie. Elle devait accepter la réalité : la fin de l’empire britannique et la montée en puissance des pays asiatiques. Elle devait admettre les implications de sa position géographique. Elle conduisit donc les changements qui s’imposaient, tout en préservant des éléments importants de son identité : des liens symboliques avec la Grande-Bretagne, une démocratie parlementaire, et un individualisme fort.
Deuxième partie – Les nations et le Monde : des crises en cours
Quel avenir pour le Japon ?
Le Japon est la troisième économie mondiale et la première nation créancière du monde. L’espérance de vie y est la plus élevée, et c’est la troisième nation la plus égalitaire en termes de répartition des revenus3. Il n’en est pas moins confronté à trois problèmes graves.
Le premier est le vieillissement de la population, qui déstabilise les systèmes de sécurité sociale et de retraite par un rapport actifs/inactifs de plus en plus faible. Un facteur essentiel est le rôle traditionnel des femmes, qui limite fortement leur possibilité de travailler dès lors qu’elle ont un enfant4 . Cela réduit la main d’œuvre disponible et provoque une baisse de la natalité, les femmes retardant l’âge du premier enfant. Cette dénatalité entraîne depuis 2010 une baisse démographique importante5. Le Japon n’est certes pas le seul pays à avoir un problème de diminution de la population active ; mais c’est un des plus fermé à l’immigration, du fait de son homogénéité ethnique et de sa longue histoire d’isolement, et cela aggrave sa situation.
Le second problème est la menace que pourrait représenter ses relations avec la Chine et la Corée. Le Japon continue de leur disputer la possession de petites îles6, alors que ces pays sont bien plus peuplés, qu’ils sont armés, et qu’ils n’ont pas pardonné les exactions commises à leur encontre par le Japon, exactions pour lesquelles celui-ci n’a jamais présenté d’excuses jugées sincères.
Le troisième est que le Japon est totalement dépendant de l’importation de ressources tant renouvelables que non renouvelables, y compris pour son alimentation. Il devrait donc se mobiliser pour une gestion renouvelable des ressources dans les autres pays, or c’est l’inverse qui se produit pour l’instant.
Il y a un espoir que le Japon surmonte ces crises, car il a su à deux reprises déjà s’auto-évaluer et opérer des changements sélectifs : lors de la restauration de Meji et après la seconde guerre mondiale. Il bénéficie d’une identité et d’une cohésion nationales fortes, et du soutien – ou au mois de la neutralité – de ses nombreux partenaires commerciaux. Enfin, il peut bénéficier de modèles pour évoluer s’il le souhaite ; il pourrait notamment s’inspirer du Canada pour ce qui est de l’immigration.
Quel avenir pour les États-Unis ?
Les États-Unis disposent de l’économie et de l’armée les plus puissantes au monde, ainsi que d’un très vaste territoire fertile. Ils sont autonomes pour beaucoup de ressources, et notamment sur le plan alimentaire. Enfin, ils bénéficient d’un régime démocratique ininterrompu depuis 230 ans. Mais il arrive qu’un pays gaspille ses avantages, et ce pourrait être son cas s’il ne résout pas les quatre problèmes majeurs qui l’affectent.
Le problème le plus dangereux auquel il doit faire face est la perte de sa capacité à bâtir des compromis politiques. Il se développe une polarisation politique, accompagnée d’intolérance et de comportements abusifs, qui menace la démocratie. Le risque est moins celui d’un coup d’État comme au Chili, que celui d’un parti qui, une fois au pouvoir, en abuserait pour manipuler les institutions à son avantage et détruire toute opposition.
Un autre problème est l’absence de participation d’une grande partie des citoyens à la vie démocratique. Près de la moitié des électeurs potentiels ne votent pas aux présidentielles, soit par désintérêt, soit parce qu’ils ne le peuvent pas. En effet, dans de nombreux États, l’inscription sur les listes électorales est gérée par des instances partisanes, qui découragent de multiples manières les citoyens de l’autre bord et notamment les citoyens pauvres ou d’origine étrangère.
Le troisième problème est le niveau élevé d’inégalités économiques, qui ne fait que s’accroître. Il est plus fort que dans les autres grandes démocraties, avec en outre une mobilité socio-économique plus faible. Le fait que les pauvres peuvent moins voter et que les riches financent des campagnes électorales au coût toujours plus astronomique aggrave les choses. La frustration qui en résulte constitue un risque d’émeutes.
Le quatrième est la baisse des investissements dans le capital humain et dans le secteur public. Or l’avantage concurrentiel dont bénéficient aujourd’hui encore les États-Unis est fondé sur leur longue histoire d’investissement public et privé dans l’éducation et la recherche. Cet avantage est désormais menacé.
Au regard des facteurs influant sur le dénouement d’une crise nationale, les États-Unis souffrent de plusieurs handicaps : l’absence de consensus sur la nature des problèmes ; la tendance à imputer les problèmes à d’autres (la Chine, le Mexique, les immigrants illégaux… ) ; l’arrogance qui les empêchent de prendre modèle sur d’autres – le Canada ou l’Europe notamment.
L’avenir des États-Unis dépend de la capacité des américains à construire une clôture, non pas le long de la frontière mexicaine, mais entre les éléments de leur société qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnement pas.
Quel avenir pour le monde ?
Quatre menaces pèsent sur la civilisation à l’échelle mondiale : les armes nucléaires, le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles, et les conditions de vie inégalitaires.
L’explosion d’armes nucléaires peut, dans le pire des scénarios, provoquer un hiver nucléaire qui causerait la mort de la plupart des humains. L’irrationalité de certains dirigeants, la possibilité d’une erreur stratégique, celle d’une fausse alerte due au dysfonctionnement d’un système de détection, ou encore celle de l’accès d’une organisation terroriste à l’arme nucléaire, sont les causes potentielles d’une catastrophe nucléaire.
Le changement climatique entraîne sécheresses, baisse de la production agricole, développement des maladies tropicales et élévation du niveau de la mer. Ces conséquences néfastes pour les sociétés humaines ne sont cependant pas inéluctables : puisque ce phénomène est généré par les activités humaines, il nous suffit de les réduire.
La pénurie de ressources, en particulier l’eau et le bois, a déjà dans le passé provoqué des guerres et imposé des limites à des sociétés – voire entraîné leur effondrement. Aujourd’hui le risque de pénurie concerne plus de ressources encore : les combustibles fossiles, les sols fertiles, les poissons et coquillages, les minéraux nécessaires à l’industrie, et même une atmosphère saine. Le risque de conflit visant à s’accaparer une ressource augmente avec le risque de pénurie.
Les inégalités entre pays ont atteint un niveau inégalé. Un américain consomme en moyenne 32 fois plus de ressources qu’un habitant d’un pays pauvre. Ces disparités provoquent colère et frustration. Elles alimentent le terrorisme, même si elles n’en sont pas la seule cause. Or il est impossible que les pays pauvres atteignent le niveau de vie des pays riches : cela décuplerait la consommation de ressources. Les pays riches devront en réalité abaisser leur consommation, que ce soit volontairement ou non, et ils ne devraient pas regarder cela comme un sacrifice mais juste un renoncement au gaspillage.
Pour relever ces défis, l’humanité manque d’une identité et de valeurs partagées, d’une autre planète habitée à qui demander de l’aide ou sur laquelle prendre exemple, et d’expérience. En outre, on ne constate ni reconnaissance mondiale de cette crise, ni acceptation mondiale de notre responsabilité, ni auto-évaluation honnête à l’échelle mondiale.
Il existe toutefois deux motifs d’espoir. Le premier est que les pays du monde ont su par le passé conclure des accords internationaux, comme ceux qui ont permis l’éradication de la variole et la protection de la couche d’ozone ; l’accord de Paris sur le Climat est également encourageant, même s’il est insuffisant. Le second est que, si les problèmes s’aggravent, la prise de conscience s’accroît. Une course est ainsi engagée dont on connaîtra l’issue dans peu de décennies.
Ce que j’en retiens
On peut reprocher à Diamond d’avoir dans cet ouvrage, plus encore que dans Effondrement, forcé ses exemples à rentrer dans sa grille d’analyse, sans que cela soit toujours très pertinent. Par ailleurs, sa liste des problèmes auquel est confronté le monde n’est pas, à mon avis, complète. Il y manque notamment l’effondrement de la biodiversité.
Pour autant, il y a des enseignements à retenir pour nous aider à y voir plus clair sur les facteurs qui conditionnent nos chances de surmonter les actuelles crises écologique et socio-économique.
Il n’est, tout d’abord, pas inutile de rappeler que l’humanité ne fera face à la crise écologique que si tous les pays admettent que cette crise existe bel et bien, et que les humains en sont à l’origine. C’est enfin le cas, mais cela reste fragile, suspendu notamment au résultat des élections présidentielles de 2024 aux États-Unis. De plus cette prise de conscience n’est que partielle, ne prenant en compte que la crise climatique et dans une certaine mesure la crise de la biodiversité, sans considérer encore le caractère systémique de la crise écologique.
La notion que je trouve la plus intéressante dans l’analyse de Diamond, c’est celle de changement sélectif. Même face à une crise majeure, on n’est pas obligé de tout changer pour s’en sortir, pour peu qu’on soit capable d’identifier avec honnêteté et réalisme les éléments de la société qui sont à l’origine du problème. Pour éviter la sidération face à un changement aussi massif que celui que nous avons à opérer, avoir une vision claire de ce qui peut être conservé, ce qui continuera de fonder notre société, est un facteur décisif.
Il est également important de noter que dans les changements à opérer peuvent se trouver des valeurs qui font partie de l’identité nationale ; et rassurant de savoir que l’Australie, par exemple, a été capable d’opérer très rapidement des changements radicaux en la matière, dès lors que la prise de conscience a été suffisante. Si l’Australie a pu renoncer à la politique de « l’Australie blanche » qui paraissait lui être consubstantielle, alors les États-Unis peuvent peut-être renoncer à leur « mode de vie non négociable ». Peut-être même les pays occidentaux dans leur ensemble peuvent-ils prendre conscience de la part de colonialisme qui demeure dans leur identité, et y renoncer. Cela lèverait un handicap majeur dans la construction d’une stratégie partagée avec les États du Sud global pour affronter la crise écologique, et permettrait de profiter des exemples aujourd’hui souvent méprisés que fournissent les peuples premiers.
S.F.G.
1NDLR – Cette doctrine a perduré jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette invasion et l’aide apportée à l’Ukraine par les États-Unis et l’Europe conduisirent la Finlande à modifier sa stratégie et à rejoindre l’OTAN le 4 avril 2023.
2retrait du Vietnam, reconnaissance de la République populaire de Chine, indépendance de la Papouasi-Nouvelle-Guinée
3après le Danemark et la Suède
4Ndlr le taux d’emploi des femmes qui ont un enfant est d’environ 50% au Japon contre environ 80% en France
5Ndlr 128,1 millions en 2010, 122,4 en 2022
6Ndlr les îles Sensaku avec la Chine, et les îles Dokdo avec la Corée du Sud
Un avis sur « Bouleversement, de Jared Diamond »