publié le 20 décembre 2020
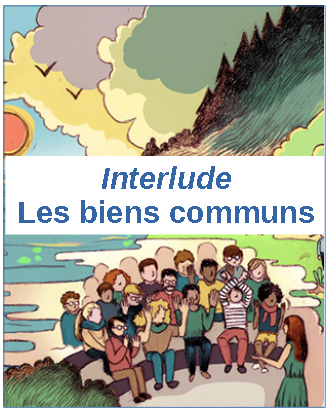
Ceux de ma génération se souviennent des interludes entre deux émissions de télévision, et du petit train qui nous proposait d’entraîner notre mémoire visuelle. Je vous propose pour ma part d’entraîner notre propre réflexion, après la découverte dans ce blog de deux ou trois ouvrages, sur une des questions qu’ils soulèvent.
Dans ce premier interlude, attardons-nous sur un concept mis en avant tant par Julien Dossier que par Gaël Giraud : les biens communs. Il s’agit en effet d’un concept clef pour penser un autre modèle sociétal, qui soit capable de préserver notre écosystème.
De plus en plus souvent, ce concept est désigné en Français simplement par « les communs », comme il l’est en anglais par « commons ». Le mot « commun » est très ancien et continue le latin communis « qui appartient à plusieurs » d’où, au figuré, « qui est accessible à tous, avenant ».1
En économie, un bien commun est une ressource matérielle (souvent naturelle) ou immatérielle, (comme la connaissance) librement accessible à une communauté plus ou moins vaste et aux individus qui la composent. Ces biens sont en général susceptibles d’être affectés par l’usage qui en est fait. On pense le plus souvent à l’impact quantitatif d’une consommation excessive, comme pour une zone de pêche, mais il peut aussi s’agir d’une altération qualitative due à un usage inapproprié, comme pour l’air, altéré par son usage comme réceptacle d’émissions diverses.
En 1968, le biologiste Garrett Hardin publiait la tragédie des communs, dans laquelle il entendait montrer que la propriété commune est incompatible avec la préservation des ressources. Il s’appuyait sur une expérience de pensée, selon laquelle un pâturage détenu en commun par plusieurs éleveurs soucieux chacun de leur propre prospérité, se trouve nécessairement ruiné. Ce texte a été très utilisé par le courant néolibéral des années 1970-1980 pour défendre la propriété exclusivecomme seul outil rationnel de gestion des ressources2.Cette théorie était pourtant démentie par les fait : de nombreux exemples prouvent le contraire.
Elinor Ostrom, comme le rappelle Gaël Giraud dans Illusion financière, a étudié de tels exemples, qui pouvaient concerner des communautés de 10 à 14 000 personnes, et dont certains fonctionnaient avec succès depuis 100 voire 1000 ans. Ses travaux, conduits avec Oliver Williamson, ont reçu le prix Nobel d’économie en 2009.
Elle démontre que « l’image d’individus impuissants pris dans un inexorable processus de destruction de leurs propres ressources » est un a priori et que, au contraire, des hommes et des femmes « peuvent conclure des accords contraignants en vue de s’engager dans une stratégie coopérative qu’ils élaboreront eux-mêmes ».
Si l’on s’en tient à la définition économique, les biens communs sont communs par nature, comme l’eau ou les poissons, ou par choix social, comme internet. Leur caractère commun n’est lié qu’à leur accessibilité. Pour Elinor Ostrom toutefois, une déclaration d’intention ne suffit pas : un bien commun est une ressource qui est devenu commune par une action d’appropriation collective par des personnes qui s’auto-organisent pour assurer sa gestion, avec un ensemble de règles contraignantes. Un bien commun n’a donc pas d’existence préétablie, et est défini comme bien commun par une communauté qui a décidé de le considérer mais aussi de le gérer comme tel.
Ainsi, résume Pierre Thomé3, faire commun suppose : une ressource, un collectif (ou communauté) agissant sur cette ressource, et un ensemble de règles de gouvernance co-définies par le collectif. Ces trois éléments forment alors un tout social, économique et démocratique cohérent et intégré.
Pour Elinor Ostrom, les biens communs ainsi définis sont la manière la plus efficace de gérer nos ressources naturelles, en dépassant le clivage public/privé et en responsabilisant les usagers. Finalement, ce qui garantit la pérennité de la ressource, ce n’est pas son statut, public ou privé, mais la gouvernance mise en place pour la gérer, et la reconnaissance de la légitimité de cette gouvernance y compris par les institutions.
En France, un exemple qui s’approche de ce concept est la gestion de l’eau via les agences de l’eau, qui, comme le rappelle Julien Dossier dans Renaissance écologique, permettent d’arbitrer entre les différents usages de l’eau sur un bassin versant avec l’ensemble des parties prenantes. Lorsque Julien Dossier appelle à une gouvernance de ce type pour l’usage des sols, il appelle implicitement à faire du sol un bien commun.
Gaël Giraud va bien au-delà des ressources naturelles, et propose de faire de la monnaie et du travail, notamment, des biens communs. Pour lui, l’euro devrait être un bien commun géré dans le cadre d’une Europe confédérale. Il existe d’ailleurs déjà des monnaies qui sont des biens communs : les monnaies locales, créées dans certaines villes ou régions4.
Pour faire du travail, un bien commun, Gaël Giraud estime qu’il faut réviser le droit des entreprises et redéfinir l’entreprise comme communauté de projets. Actuellement, c’est dans la sphère de l’économie sociale et solidaire que le travail est le plus considéré comme un bien commun des salariés et des usagers des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Mais on peut aussi penser aux expériences « territoires zéro chômeurs de longues durée »: dans ces territoires, un comité local est mis en place pour définir les besoins non couverts du territoire, pour rencontrer les personnes privées durablement d’emploi afin de connaître leurs compétences et aspirations, et pour piloter la création d’entreprises à but d’emploi. Il me semble que dans son principe cette démarche revient à faire du travail un bien commun à l’échelle du territoire.
Comme nous le recommande Gaël Giraud, nous devrions choisir nos biens communs et convenir de la gouvernance la plus à même d’en assurer la pérennité. C’est un travail à conduire à chaque échelle territoriale. Il s’agit là du fondement des politiques publiques à conduire, et même de la politique elle-même. Ce serait une démarche propre à refonder un projet collectif, et à revitaliser la démocratie en re-débattant de ce que nous voulons avoir en commun et en le gérant ensemble.
Et vous, qu’en pensez-vous ?5
Pour en savoir plus, lire l’article de Pierre Thomé paru en 2014 dans le blog Utopies :
S.F.G.
1Dictionnaire Historique de la langue française, d’Alain Rey
2https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/06/hardin-tragediedescommuns_locher_2013.pdf
3Pierre Thomé est l’auteur de (Biens) communs, quel avenir ? et de Créateurs d’utopies
4https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monnaies_locales_compl%C3%A9mentaires_en_France
5J’aime beaucoup cette interpellation par laquelle la philosophe Pascale Seys nous invite à réfléchir dans les Tics de l’actu
3 commentaires sur « Interlude: les biens communs »